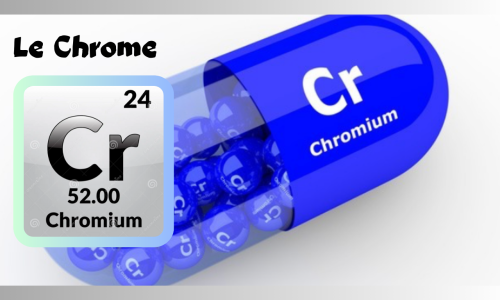Le régime cétogène
Extrait total de: biologie-open edition journal
Le régime cétogène est une alternative dirigé vers une restriction importante en sucres, favorisant des apports en matière de lipides pour mettre le corps dans un état de cétose, c’est-à-dire obliger le métabolisme à produire des corps à produire de l’énergie à partir des cétones. Dans certaines pathologie grave, tel que le cancer qui touche tout type de tissu et qui tue chaque année en France plus de 150 000 personnes. Les cellules cancéreuses présentent des modifications dans leur métabolisme par rapport aux cellules saines, puisqu’elles tirent leur énergie très majoritairement de la glycolyse anaérobie et non de la phosphorylation oxydative mitochondriale, on parle de l’effet Warburg. À l’heure actuelle, les traitements les plus utilisés pour soigner le cancer en routine sont des traitements dits non spécifiques qui présentent de nombreux effets secondaires, altérant la vie des personnes atteintes.
Il semble de plus en plus crucial de trouver de nouvelles stratégies pour lutter contre la progression des cellules cancéreuses. Le régime cétogène, pauvre en sucres et riche en lipides, est un candidat intéressant, puisqu’il affaiblit la machinerie énergétique de la cellule cancéreuse. Ce régime est déjà utilisé dans le cadre de la prise en charge de l’épilepsie réfractaire aux traitements classiques, et commence à être étudié en cancérologie également. Cet article, qui fait le point sur les preuves scientifiques des effets bénéfiques du régime cétogène, souligne son intérêt thérapeutique potentiel comme traitement complémentaire pour lutter contre certains cancers. Selon ses partisans, sa mise en œuvre est à présent mieux maitrisée, en diminuant les contraintes par une diversification des aliments et via un calcul simplifié de la part de lipides et non-lipides à absorber « La tolérance de ce régime au long cours est bonne, mais, une supplémentation en vitamine et en oligoéléments serais souhaitable.
Cellules cancéreuses : généralités et effet Warburg
Avec le temps, les cellules du corps humain peuvent accumuler des mutations dues à des agents toxiques, infectieux, aux rayons UV ou au mode de vie. (Blackadar, 2016). Si ces mutations ne sont pas réparées et s’accumulent dans une même cellule, cette dernière peut passer d’un état sain à un état cancéreux. Une cellule cancéreuse est définie comme étant capable de résister à l’apoptose, induire l’angiogenèse, être immortelle, échapper au système immunitaire et aux suppresseurs de tumeurs, présenter une instabilité du génome et des mutations, promouvoir l’inflammation, exprimer ses propres signaux de croissance et enfin déréguler son métabolisme. (Hanahan & Weinberg, 2011). Ce dernier critère connaît un véritable essor dans la communauté scientifique, pourtant déjà décrit dès 1956 par Otto Warburg dans son article « On the origin of cancer cells ». (Warburg, 1956). En effet, Warburg a découvert que la cellule cancéreuse possède un métabolisme différent de celui des cellules saines et qu’elle privilégie l’utilisation de la glycolyse anaérobie plutôt que la phosphorylation oxydative qui a lieu au sein des mitochondries, indépendamment de la quantité d’oxygène présente dans le microenvironnement (phénomène appelé « effet Warburg »). Ce changement métabolique est adaptatif, puisque lorsque la tumeur se développe, le micro-environnement tumoral s’appauvrit en oxygène, et pour survivre, les cellules tumorales qui dépendent très peu de la phosphorylation oxydative pour produire leur ATP, obtiennent un avantage sélectif. (Hsu & Sabatini, 2008). De plus cet environnement hypoxique active le facteur de transcription HIF-1, qui stimule l’angiogénèse et permet un apport plus conséquent en glucose aux cellules cancéreuses et donc d’alimenter leur glycolyse anaérobie.
Une autre raison de ce changement métabolique sont les mutations d’oncogènes qui peut stimuler la glycolyse. (Ramanathan et al., 2005), ou encore la mutation de gènes suppresseurs de tumeurs comme p53, qui engendre des dysfonctions de la chaîne respiratoire mitochondriale. (Matoba et al., 2006).
Favoriser la voie de la glycolyse anaérobie peut sembler étonnant car elle est moins efficace pour produire de l’Adénosine-Tri-Phosphate (ATP). En effet, elle ne produit que deux molécules d’ATP, alors que la phosphorylation oxydative en produit 36. Cependant, cette particularité métabolique confère d’autres avantages à la cellule cancéreuse. En effet, en condition d’hypoxie, la cellule cancéreuse continue d’assurer la production de précurseurs d’acides nucléiques, de lipides et de protéines utiles à sa croissance. (Malthièry & Savagner, 2006). De plus, un autre substrat, précieux pour la cellule cancéreuse, est formé par la fermentation du glucose : le lactate. HIF-1 et la surexpression d’oncogènes, comme par exemple c-myc, engendrent la surexpression de la lactate déshydrogénase, qui convertit le pyruvate en lactate. Ainsi, une grande quantité de lactate est produite, qui, de par son rôle de source énergétique, de précurseur de la néoglucogénèse et de molécule de signalisation, est au centre de la carcinogenèse. Il peut en effet stimuler le VEGF (Vascular Endothelium Growth Factor) et donc l’angiogenèse, promouvoir la migration cellulaire, participer à l’échappement vis-à-vis du système immunitaire et finalement acidifier le microenvironnement tumoral, favorisant l’invasion cellulaire. (San-Millán & Brooks, 2017).
Enfin, comme la tumeur nécessite une quantité importante d’ATP afin de croître, les cellules cancéreuses surexpriment des transporteurs du glucose tels que le GLUT1 (Glucose Transporter 1) pour faire entrer le glucose plus rapidement dans son cytosol et ainsi produire l’ATP dont elle a besoin et au rythme qui lui convient. (Adekola et al., 2012).
Les traitements actuels du cancer et leurs limites
Actuellement, la majorité des cancers est traitée par chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie en fonction de leur localisation, stade, taille et de la présence de métastases. Ces traitements de première intention sont dits non spécifiques (c’est-à-dire qu’aucune distinction entre les types de cancer n’est faite) et causent des effets secondaires majeurs.
Les principes de l’alimentation cétogène
L’alimentation cétogène, appelée également Keto Diet (KD), est basée sur une restriction en sucres et un apport important en lipides pour mettre le corps dans un état de cétose, c’est-à-dire obliger le métabolisme à produire des corps cétoniques. (Sumithran & Proietto, 2008). Nous parlons de régime cétogène lorsque l’apport en lipides est compris entre 70 et 80 %, l’apport en protéines entre 20 et 25 % et que l’apport en glucides ne dépasse pas 10 %.
Cette alimentation a commencé à se développer dans les années 1920, où il était initialement utilisé dans la prise en charge des épilepsies réfractaires aux traitements. Dans la Rome Antique, on soignait déjà les personnes atteintes d’épilepsie par des jeûnes d’au moins trois jours. En effet, la privation de nourriture permet une restriction en glucose qui est bénéfique pour réduire le nombre de crises et pour stabiliser la maladie. (Boison, 2017). Toutefois le jeûne n’étant pas une situation durable, il ne peut être appliqué que pendant une courte durée. Dans cette situation, l’organisme doit trouver une solution pour continuer à fournir un apport énergétique aux organes puisqu’au cours du jeûne les réserves en glycogène s’épuisent rapidement. L’organisme va donc puiser dans ses réserves lipidiques pour apporter l’énergie nécessaire, mais là encore ces ressources sont limitées. (Collège des Enseignants de Nutrition, 2014). Le jeûne n’est donc pas une solution sur du long terme. L’alimentation cétogène propose une solution pour contourner cette problématique, elle maintient les apports mais diminue de manière drastique la consommation de glucose, qui est alors compensée par un apport important en lipides permettant de fournir l’énergie mais également les vitamines, minéraux et oligoéléments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme. (Pereira de Brito Sampaio, 2016). Cette stratégie peut donc être utilisée sur des durées bien plus longues.
Régime cétogène et métabolisme
Pour produire de l’ATP efficacement, le régime cétogène va induire des adaptations métaboliques très importantes. En effet, du fait de la restriction en sucres et d’apports en lipides importants, la bêta-oxydation et la phosphorylation oxydative vont être privilégiées, ceci par une augmentation de l’expression des enzymes impliquées spécifiquement dans ces voies métaboliques. (Shimizu et al., 2018).
Les organes gluco-indépendants, tels que le foie ou les muscles squelettiques, vont alors utiliser directement les acides gras comme source d’énergie. Ces derniers sont activés dans le cytoplasme sous forme d’acyl-CoA et entrent dans la mitochondrie grâce à la carnitine. Ils vont ensuite être dégradés par la bêta-oxydation, qui, à chaque cycle, raccourcit l’acyl-CoA de deux carbones, formant ainsi une molécule d’acétyl-CoA. L’acétyl-CoA va ensuite entrer dans le cycle de Krebs qui produit des équivalents réducteurs, tels que le NADH+H+ et le FADH2. Ces molécules seront ré-oxydées au niveau de la chaîne respiratoire, établissant ainsi un gradient de protons de part et d’autre de la membrane mitochondriale interne, à l’origine de la production d’ATP. (Meyer-Rogge & Meyer-Rogge, 2012) (Figure 3).
Cependant, certains organes ne sont pas capables de métaboliser les acides gras, et sont dits gluco-dépendants : c’est le cas notamment du système nerveux. En effet, les lipides franchissent difficilement la barrière hémato-encéphalique, et les mitochondries du cerveau expriment peu les enzymes de la bêta-oxydation. (Collège des Enseignants de Nutrition, 2014). Il faut donc trouver une autre source énergétique pour alimenter les organes gluco-dépendants en période de restriction glucidique : les corps cétoniques.
Les corps cétoniques sont des substrats énergétiques qui sont produits dans les mitochondries hépatiques à partir de la dégradation des acides gras puis de la transformation de l’acétyl-CoA. On en dénombre trois, l’acétone qui est évacué par voie pulmonaire, l’acétoacétate (AcAc) et le bêta-hydroxybutyrate (BHB) qui, eux, sont utilisés par les cellules nerveuses. (Meyer-Rogge & Meyer-Rogge, 2012). Ces composés sortent du foie vers la circulation sanguine via un transporteur des monocarboxylates (MCT), puis diffusent à travers la barrière hémato-encéphalique et pénètrent dans les cellules toujours via un transporteur MCT (Collège des Enseignants de Nutrition, 2014). Ils vont ensuite être transformés en acétyl-CoA, qui pourra rejoindre le cycle de Krebs et produire de l’ATP.
Quels effets du régime cétogène sur les cellules cancéreuses ?
Comme il a été précédemment évoqué, les cellules cancéreuses possèdent un métabolisme différent de celui des cellules saines et favorisent la production d’ATP via la glycolyse anaérobie et la fermentation. La croissance des cellules cancéreuses ainsi que la progression tumorale dépendent donc d’un apport conséquent en glucose. Or le régime cétogène repose sur une alimentation riche en lipides et faible en glucides. Avec une glycémie qui reste en permanence à un niveau minimum, la cellule cancéreuse ne pourra plus utiliser la glycolyse anaérobie de façon efficace pour produire suffisamment d’ATP, et sera donc obligée d’utiliser la bêta-oxydation et la phosphorylation oxydative. Cependant, du fait de l’environnement hypoxique, la production d’ATP par la cellule cancéreuse via la chaîne respiratoire est limitée. Nous supposons donc que la restriction en glucose des cellules cancéreuses par le régime cétogène engendrera un blocage de leur croissance, une réduction de leur prolifération et stimulera leur apoptose. (Allen et al., 2014) (Figure 4).
Ces hypothèses reposent sur les connaissances du métabolisme des cellules cancéreuses, et plus particulièrement sur celles concernant le lien qui existe entre le glucose, l’insuline, la voie de signalisation PI3K-Akt et le cancer. L’insuline est sécrétée suivant l’état nutritionnel, et notamment en réponse à une augmentation de la glycémie. Elle est alors produite par les cellules bêta du pancréas et va se fixer sur son récepteur appelé le récepteur à l’insuline, présent majoritairement à la surface membranaire des adipocytes, des cellules du foie et des muscles. La fixation de l’insuline sur son récepteur provoque l’autophosphorylation du récepteur et l’activation de deux voies de signalisation sous-jacentes : la voie des Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPK) et la voie PI3K/Akt. (Świderska et al., 2018). La première voie active des gènes de croissance et de différenciation cellulaire, alors que la seconde active des gènes impliqués dans le métabolisme, la prolifération, la migration et la survie cellulaire, comme par exemple mTor ou Bax. (Faes & Dormond, 2015). La voie PI3K-Akt permet une translocation des transporteurs de glucose (GLUT) à la surface membranaire, augmentant ainsi l’entrée de glucose dans la cellule. Les enzymes impliquées dans ce processus sont souvent mutées dans les cancers. (Adekola et al., 2012), ce qui induit la croissance tumorale. De nouvelles thérapies ont été développées pour cibler cette voie, comme les inhibiteurs des PI3K. Ces derniers ont le potentiel de diminuer la prolifération cellulaire ainsi que d’augmenter l’apoptose, mais leur utilisation seule est limitée car des mécanismes de résistance se mettent, à terme, en place. (Yang et al., 2019). En effet, pour compenser l’inhibition de PI3K, le pancréas surproduit de l’insuline, ce qui stimule à nouveau la voie PI3K/Akt et explique les effets limités du traitement. Les inhibiteurs de PI3K pourraient être potentialisés s’ils étaient utilisés en combinaison avec un traitement visant une autre cible de la même voie. (Hopkins et al., 2018). En particulier, l’utilisation du régime cétogène pourrait améliorer leurs effets puisqu’il permet de réduire l’insulinémie et surtout les pics d’insuline en période postprandiale. (Kosinski & Jornayvaz, 2017 ; Gupta et al., 2017). Ce type d’approche permettrait ainsi de limiter la compensation de la voie PI3K/Akt, mais aucune expérimentation n’a encore été réalisée pour le démontrer, que ce soit chez l’animal ou chez l’Homme.
Ainsi, plusieurs arguments sont en faveur de l’utilisation du régime cétogène comme complément de thérapies anticancéreuses déjà existantes. Il commence d’ailleurs à être étudié dans des modèles animaux et chez l’Homme, notamment dans le cas de tumeurs malignes du cerveau et dans le cancer du sein.
Le régime cétogène et les tumeurs malignes du cerveau
Les tumeurs malignes du cerveau, comme par exemple le glioblastome multiforme (GBM), sont des tumeurs dévastatrices, généralement de mauvais pronostic. Le GBM est le cancer le plus fréquent des cancers cérébraux et touche 2400 nouveaux cas en France chaque année. (Bauchet et al., 2007). C’est un cancer très agressif, avec une espérance de vie médiane de 15 à 17 mois et un taux de survie de 5 % à cinq ans. (Dieudonné-Rahm et al., 2016).
Habituellement, le traitement du GBM est basé sur une résection chirurgicale de la tumeur suivie d’une chimiothérapie et/ou une radiothérapie.
Les études sur le modèle murin montrent un intérêt quant à l’utilisation d’un régime cétogène en plus du traitement classique du GBM. En effet, dans l’étude de Abdelwahab et al. (2012), les animaux traités uniquement par radiothérapie présentaient une médiane de survie de 43 jours, avec la mort de tous les animaux de l’effectif après 150 jours, alors que ceux traités par radiothérapie associée à un régime cétogène présentaient une médiane de survie indéfinie car après 250 jours, plus de 75 % de l’effectif était encore en vie. De plus, 9 des 11 animaux de l’effectif traité par radiothérapie et régime cétogène semblaient avoir guéri de leur tumeur, car, après 48 jours, la bioluminescence associée à la tumeur avait disparu chez ces animaux.
Chez l’Homme, les études sont encore trop peu nombreuses et demandent à être approfondies afin de mettre en évidence le rôle du régime cétogène dans l’amélioration de l’efficacité de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Cependant, les premiers résultats sont prometteurs puisqu’ils montrent que les patients tolèrent bien le régime, et que l’utilisation d’un régime cétogène comme adjuvant des traitements standards du GBM est faisable et sans danger. (Rieger et al., 2014 ; Van der Louw et al., 2019). Néanmoins, des études randomisées avec un nombre important de patients tardent à voir le jour.
Le régime cétogène et le cancer du sein
Le régime cétogène semble prometteur dans le cadre du traitement du cancer du sein. Ce cancer est le plus fréquent chez la femme, avec 56 162 nouveaux cas en 2018. (Bray et al., 2018), et est généralement traité par une ablation de la tumeur, une radiothérapie, une chimiothérapie ou une hormonothérapie. (Sarosiek, 2017).
L’étude de Khodabakhshi et al. (2020), a mis en évidence que l’utilisation d’un régime cétogène potentialise le traitement par chimiothérapie. En effet, ils ont pu démontrer que cette alimentation est bien tolérée, sans danger, et améliore la survie des patients. Le taux de survie global était plus élevé dans le groupe qui suivait un régime cétogène associé à la chimiothérapie par rapport à celui traité par chimiothérapie seule. L’apport du régime cétogène en plus du traitement par chimiothérapie semble se situer au niveau de la voie de l’insuline, comme précédemment expliqué, entraînant un ralentissement du développement tumoral.
De plus, le régime cétogène induit chez ces patients une perte de masse grasse, ce qui peut aussi agir sur le développement de la tumeur. En effet, il a été démontré que des niveaux élevés d’insuline chez les femmes en surpoids ou obèses stimulent la synthèse des stéroïdes sexuels, entraînant ainsi une progression de leur cancer (Cozzo et al., 2017). Une masse grasse trop élevée conduit également à un état d’inflammation chronique, qui augmente à son tour le développement du cancer (Deng et al., 2016). Ainsi, la perte de poids et la diminution de la production d’insuline médiée par le régime cétogène permettent de réduire l’environnement favorable à la tumeur, et de limiter son expansion. (Khodabakhshi et al., 2020), ce qui optimise l’efficacité du traitement par chimiothérapie.
Limites et effets secondaires du régime cétogène
La principale limitation de ce type de régime est très certainement qu’il est exigeant, assez difficile à respecter sur le long terme et peut poser des problèmes sur le plan social. Il nécessite un encadrement médical et il est compliqué de le proposer chez des personnes isolées, fatiguées, notamment au moment de leur traitement par chimiothérapie. Ce régime demande un changement d’habitude alimentaire très important, surtout si les patients étaient accoutumés à consommer une quantité importante de sucre.
De plus, il semble que ses effets bénéfiques s’estompent sur le long terme. (Kosinski & Jornayvaz, 2017). En fonction de la pathologie, du type de cancer et de la composition du régime, cette durée peut varier, mais cette baisse d’effets bénéfiques et l’apparition d’effets délétères ont lieu pour des traitements à très long terme comme dans l’épilepsie, où le régime peut être mis en place pendant plusieurs années. Ainsi, une future utilisation du régime cétogène sera envisagée sur une période de quelques mois pour garantir l’intérêt et les propriétés de cette alimentation. Concernant le traitement du cancer, les régimes cétogènes sont globalement bien tolérés et il n’y a pas d’effets secondaires graves rapportés, à partir du moment où le régime contient un apport suffisant en protéines et minéraux. (Klement et al., 2020).
Certains symptômes bénins peuvent cependant apparaître dans les premiers jours de suivi du régime, avec des nausées, des douleurs abdominales, des constipations et des céphalées. Les détracteurs du régime cétogène arguent que ce type de régime peut entraîner un état d’acidose métabolique, avec des cétones à plus de 15 mmol/l. Néanmoins, à notre connaissance, aucune étude n’a démontré la survenue d’une telle acidose chez des patients ayant pratiqué un régime cétogène sur plusieurs semaines. C’est uniquement lorsqu’il est suivi pendant plusieurs années que des effets secondaires importants peuvent apparaître. Chez certains enfants épileptiques soumis à un régime cétogène strict, il a été trouvé des signes d’ostéoporose, une hyperlipidémie et une croissance anormale. (Bergqvist, 2012). Cependant dans le traitement du cancer, il n’est pas envisagé de dépasser 6 mois de régime cétogène à la suite. Les recommandations sur du long terme sont généralement moins drastiques avec uniquement une réduction de l’usage du sucre, mais là encore les médecins manquent de données scientifiques concernant les bonnes pratiques pour ce type de régime. Faut-il par exemple procéder à ce type de régime une fois par an pendant deux ou trois mois afin de diminuer les risques de récidives ? Il reste un nombre important de questions sans réponse qui nécessitent la réalisation d’études cliniques afin d’améliorer la prise en charge de patients atteints de cancer.
Les voies métabolique des cellules saines et cancéreuses
LA cellule cancéreuse et la cellule saine. La cellule saine utilise la glycolyse pour produire du pyruvate qui servira à alimenter le cycle de Krebs, et privilégie la voie de la phosphorylation oxydative de la mitochondrie pour produire de l’ATP. Au contraire, la cellule cancéreuse utilise la glycolyse et la voie de la fermentation afin de produire de l’ATP et du lactate utile à la carcinogénèse. Elle délaisse la voie de la phosphorylation oxydative.